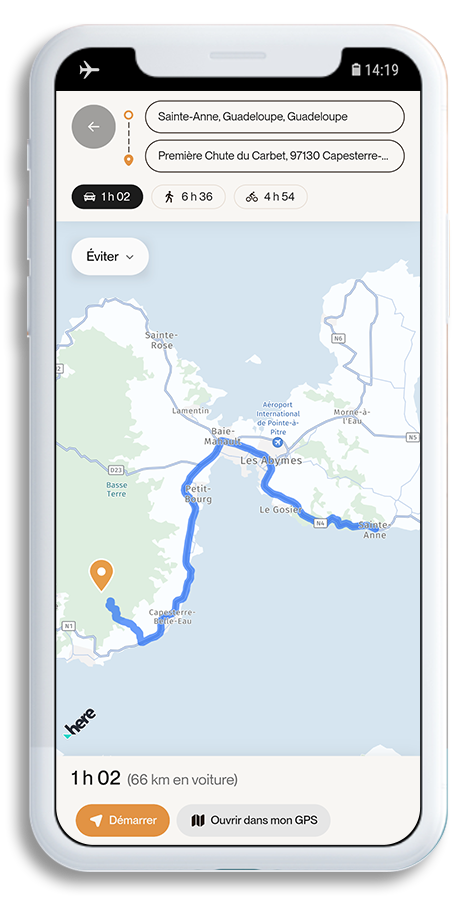Lexique de survie créole
Si le français est langue officielle, les Guadeloupéens parlent volontiers créole. Ce système linguistique autonome est issu du contact d'une langue européenne avec des langues indigènes ou importées. Comme les autres créoles antillais, le créole guadeloupéen (kréyòl gwadloupéyen) a été formé autour du français du XVIIIe siècle et de plusieurs langues d'Afrique de l'Ouest, puis enrichi d’apports anglais, portugais, indiens…
Au minimum
Bonjour / Bonsoir : Bonjou / Bonswa
Au revoir : Ovwa
Oui / Non : Wi / Vonn
S’il vous plaît / Merci : Si ou plé / Mési
De rien / Je vous en prie : Pa ni pon pwoblèm / Si ou plé
Comment allez-vous ? : Sa ou fè ?
Très bien, merci, et vous ? : Bien mèsi, é zot ?
Veuillez m’excuser : Eskisé
Bravo !
Kontan wè zot
Littéralement, « nous sommes contents de voir vous ». Prononcée en guise de bienvenue, cette phrase est beaucoup utilisée pour accueillir les voyageurs et vous l’entendrez certainement.
Lanné kannèl
Parler de la réalisation d'une action à la « saison de la cannelle » est une façon de la repousser indéfiniment. Car la cannelle est l’écorce d’un arbre et non son fruit, qui n’existe d’ailleurs pas.
Épatez vos amis
… en connaissant les surnoms du rhum apparus à l’apogée de l’économie sucrière. On raconte qu’au moment de débuter leur dure journée, les coupeurs de canne buvaient un « décollage », du rhum pris à jeun. Dans la matinée, ils se donnaient du courage avec un « sec » (rhum pur) ou du « feu » (rhum additionné de citron et de sucre). Pour patienter avant le ti punch de midi, bu traditionnellement en trois gorgées, on s’offre un « ti lagoutte » et pour digérer un « ti 50 % », la moitié d’un ti punch. Plus recueillie, l’après-midi est entrecoupée de « l’heure du Christ » et du « ti pape », pris respectivement à 15 h et 17 h. Le « pété pied » qui conclut la journée risque – comme son nom l’indique – de faire tomber celui qui le boit et qui pourrait avoir du mal à marcher droit.