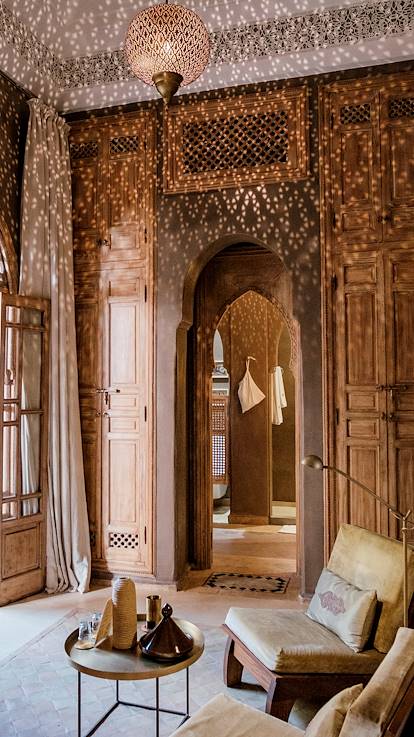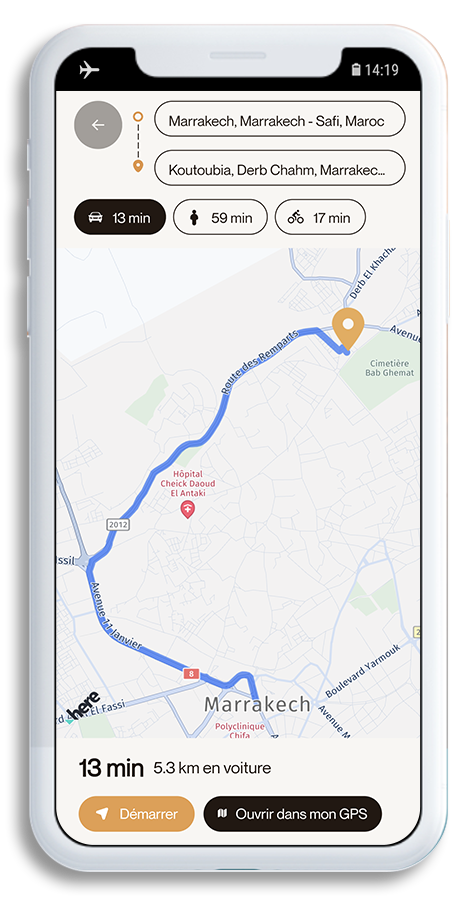L'environnement au Maroc
Face à l’aridification croissante, au stress hydrique et aux effets du changement climatique, le Maroc déploie des politiques et innovations pour préserver ses ressources naturelles.
Un environnement sous pression
Le Maroc est aujourd’hui l’un des pays les plus exposés à la rareté de l’eau. Le prélèvement actuel dépasse déjà 50 % des ressources renouvelables disponibles selon l’OCDE, mettant en péril les équilibres des écosystèmes et la sécurité alimentaire. Depuis plusieurs décennies, les températures moyennes au Maroc grimpent plus vite que la moyenne mondiale, alors que les précipitations diminuent, augmentant la fréquence des sécheresses sévères. La pollution urbaine, la dégradation des sols, le stress côtier et la salinisation des nappes complètent le tableau des pressions environnementales du Royaume.
Ambitions, stratégies et réalisations
Pour limiter son empreinte carbone, le Maroc s’est fixé l’objectif ambitieux de réduire ses émissions de CO₂ de 45 % d’ici 2030 (par rapport à 2010) et de viser la neutralité carbone d’ici 2050. La transition énergétique passe par la forte promotion des énergies renouvelables — solaire, éolien, hydroélectrique — avec des projets emblématiques comme la centrale solaire de Noor, près de Ouarzazate. Parmi les avancées récentes, le pays intensifie ses efforts dans le dessalement de l’eau de mer : 17 usines sont déjà en fonctionnement, et plusieurs autres sont en construction pour répondre aux pénuries d’eau dans les zones urbaines et agricoles.
Défis persistants et pistes à consolider
L’application des mesures dépend fortement des capacités institutionnelles locales. Le financement des technologies vertes peine parfois à émerger dans les territoires moins développés. Le secteur agricole, principal consommateur d’eau, doit s’adapter : améliorer les systèmes d’irrigation, revoir les rotations culturales et réduire les cultures gourmandes en eau sont des impératifs. ,Enfin, la sensibilisation citoyenne et la participation locale sont des leviers sous-exploités.
Source : OCDE, 2025